|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 2132 du 24.03.2006
Coordination pour la libération de Maître Abbou: Madame Abbou privée de visite pour son mari ! HRinfo sets up press observatory to monitor Tunisian coverage in Egyptian press Pétition- Algérie: contre l’autoamnistie, oui à la justice, non à l’impunité ! AFP: Commerce: l’UE souhaite une plus grande intégration des pays méditerranéens AFP:Euromed: libéraliser les services en vue d’une zone de libre-échange AP: France Télécom hors jeu AFP: Ouverture à Marrakech de la Conférence Euromed des ministres du commerce Lancement d’un nouveau site dedié au resistant tunisien Lazhar Chraiti Le Nouvel Observateur: Sabra et Chatila : les tueurs parlent Le Monde : Ils ont osé montrer leur Prophète Le Monde : Une étude américaine critique la politique pro-israélienne des Etats-Unis
|
Madame Abbou privée de visite pour son mari !
La Coordination a appris qu’aujourd’hui, jeudi 23 mars, Mohammed Abbou, prisonnier d’opinion incarcéré à la prison du Kef, n’avait pas été extrait de sa cellule pour rejoindre le parloir. Le jeudi est le jour de la visite. Et sa famille vient de Tunis pour le rencontrer.
Madame Samia Abbou, accompagnée de ses trois jeunes enfants et de la mère de son mari, s’est vu signifier l’interdiction de lui rendre visite sans qu’aucune justification sérieuse ne lui soit apportée, sinon de vagues prétextes « il est puni ».
Jointe par téléphone, Mme Samia Abbou nous a confirmé les faits.
Madame Samia Abbou a demandé à rencontrer le directeur de la prison, sa demande a été rejetée, elle a également demandé une notification par écrit de l’interdiction de visite de son mari, chose qu’on lui a refusée.
La Coordination rappelle que Mohammed Abbou est en grève de la faim depuis le 11 mars. Elle partage l’inquiétude légitime de sa famille qui s’interroge sur les vraies raisons de cette interdiction de visite.
Elle dénonce ces méthodes opaques qui punissent injustement toute une famille. Il faut savoir que les enfants n’avaient pas pu rendre visite à leur père depuis plus de deux mois et profitaient des congés scolaires pour se rendre au Kef, distant du domicile familial de plus de 250 km.
Elle exige que la vérité soit faite sur les véritables raisons qui ont poussé l’administration de la prison du Kef à refuser une visite à toute une famille.
Elle exige que Mohammed Abbou puisse bénéficier du droit à des visites directes et d’un temps raisonnable pour rencontrer les siens.
Genève, le 24 mars 2006
Pour la coordination Dabbour Mounir www.tunisieinfo.net
========================================================
Les membres de La coordination :
comunica-ch, Amnesty international groupe La Côte, CETIM Centre Europe Tiers Monde, solidaritéS, CUP Collectif Urgence Palestine, CADTM comite pour annulation de la dette du tiers monde, ATS Association des tunisien-ne-s en Suisse, UTS Union des tunisiens en Suisse.
IFEX – News from the international freedom of _expression community
PRESS RELEASE – EGYPT/TUNISIA
24 March 2006
HRinfo sets up press observatory to monitor Tunisian coverage in Egyptian press
SOURCE: Arabic Network for Human Rights Information (HRinfo),
(HRinfo/IFEX) – The following is a 23 March 2006 Hrinfo press release:
HRinfo Press Freedom Support Unit Press Observatory
On 21 March 2006, the Arabic Network for Human Rights Information (HRinfo) set up a Press Observatory to monitor the Arabic language press in Egypt, searching for what appear to be paid advertisements (disguised as articles) praising governments that are infamous for their gross violations of human rights. HRinfo is currently targeting newspapers which accept paid advertisements from the Tunisian government.
When a newspaper publishes one of these paid advertisements, HRinfo sends a standard letter addressed to the editor-in-chief, bringing their attention to the violations taking place in the country concerned and requesting that the newspaper dedicate a space to publishing information on such violations.
The Press Observatory is a new activity within HRinfo’s Press Freedom Support Unit, which has been a part of HRinfo’s core activities since its establishment in 2003.
In commemoration of the 50th anniversary of Tunisian independence, HRinfo saw fit to start monitoring Egyptian press coverage of
“Al-Ahram” published an article on 20 March 2006 entitled “In commemoration of the 50th anniversary of
“Al-Usbuu” published an article on 20 March 2006 entitled “Fifty years since
“Rozal Youssef” published an article on 18 March 2006 entitled “Freedom of _expression, fostering human rights principles and actual political participation: the pillars of the Tunisian democratic society.”
“Al-Akhbar” published an article on 21 March 2006 entitled “In his speech commemorating the 50th anniversary of
In all four cases, HRinfo drafted a standard letter, modified according to the publication. The following is a translation of the letter sent to “Al-Usbuu” on 21 March 2006:
“For the attention of: Mustafa Bakry, Editor in Chief and Board Chairman of “Al-Usbuu” Newspaper,
We have read in “Al-Usbuu” newspaper, issued yesterday, an article published on page 25 entitled “Fifty years since
Since I work for the Arabic Network for Human Rights Information (HRinfo), we know and have many documents posted on our website, issued by Tunisian civil society organizations and other international and regional organisations, which express a different opinion to that of the Tunisian government which paid for the advertisement published in your respectable newspaper.
Freedom of _expression and press, which we all call for, requires the putting forth of different viewpoints regarding the same issue. Tunisian civil society organisations and defenders of freedom of _expression and other civil and political rights disclose to the Egyptian, Arab, and international public the deterioration and violations of human rights committed by the Tunisian government.
Accordingly, we request you make room in “Al-Usbuu” newspaper to publish some of the issues and concerns of Tunisian activists working in civil society organisations and defending freedom of _expression.
It would be our pleasure to provide you with the publications that express a viewpoint that differs that which has been announced by the Tunisian government. You can also read the special section on
We thank you in advance for your positive response and we look forward to further cooperation in issues pertaining to freedom of _expression.
Best regards,
Gamal Eid
Executive Director
Arabic Network for Human Rights Information (HRinfo)
For further information contact Gamal Eid, Executive Director, at HRinfo, Apartment 10, No. 5, Street 105, from Mayan al Hurriya, al Maadi, Cairo, Egypt, tel: +202 524 9544, fax: +202 524 9544, e-mail: info@hrinfo.net, gamal4eid@yahoo.com, Internet: http://hrinfo.net/en
The information contained in this press release is the sole responsibility of HRinfo. In citing this material for broadcast or publication, please credit HRinfo.
_________________________________________________________________
DISTRIBUTED BY THE INTERNATIONAL FREEDOM OF _EXPRESSION
EXCHANGE (IFEX) CLEARING HOUSE
tel: +1 416 515 9622 fax: +1 416 515 7879
alerts e-mail: alerts@ifex.org general e-mail: ifex@ifex.org
Internet site: http://www.ifex.org/
Pétition
Algérie : contre l’autoamnistie, oui à la justice, non à l’impunité !
23 mars 2006
Le 27 février 2006, le régime d’Alger a promulgué une ordonnance de mise en œuvre des dispositions de la « Charte sur la paix et la réconciliation nationale » (adoptée en septembre 2005 par un référendum aux résultats largement truqués). Sous le prétexte de mettre un terme à la période sanglante inaugurée par le coup d’État de janvier 1992, le régime d’Alger décrète l’impunité des assassins, qu’il s’agisse des membres des groupes armés se réclamant de l’islam ou des « forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues ». Et il interdit, sous peine d’emprisonnement, d’évoquer sous quelque forme que ce soit la responsabilité des parties qui ont organisé les violations du droit et ordonné, couvert ou justifié les atrocités commises depuis près de quinze ans.
Les parents de victimes, les familles de disparus sont sommées de se taire – elle n’auront plus le droit de porter plainte – et d’oublier contre une indemnisation financière, méthode honteuse où l’outrage le dispute à l’aveuglement. Mais comment effacer la mer de sang et d’horreurs qui a submergé la société algérienne ? La seconde guerre d’Algérie – qui a porté à son paroxysme les formes perverses et inhumaines de guérilla et contre-guérilla développées au cours de la guerre d’indépendance par les forces coloniales – a coûté près de 200 000 morts, 20 000 disparus, un nombre très élevé de blessés et de personnes déplacées.
Après avoir imposé une guerre meurtrière et particulièrement « sale » au peuple algérien, les généraux putschistes qui détiennent le pouvoir réel à Alger, dont le président Abdelaziz Bouteflika n’est que le représentant diplomatique, désirent s’absoudre des crimes contre l’humanité perpétrés sous leur autorité effective, et effacer ceux de leurs anciens adversaires. En violation directe des engagements internationaux signés par l’Algérie et des principes fondamentaux du droit, cette politique d’oubli forcé est en soi un aveu éclatant de responsabilité.
Cette démarche inacceptable est clairement confortée et cautionnée par nombre de dirigeants des grandes démocraties occidentales. Motivés essentiellement par des considérations économiques, ils mettent en avant le « péril islamiste » pour justifier ce déni des valeurs universelles des droits humains.
L’autoamnistie des chefs de guerre a déjà été tentée ailleurs, notamment en Amérique latine, et partout elle a connu l’échec. Car nul ne peut disposer du pouvoir d’effacer l’histoire. Il ne peut y avoir de paix et de réconciliation sans vérité ni justice. Le peuple algérien connaît son histoire et aucune manœuvre ne peut effacer des crimes imprescriptibles. Vouloir lui imposer le silence par la menace est strictement illusoire.
Les femmes et les hommes à travers le monde épris de liberté, signataires de ce texte, rejettent cette loi d’un autre âge et appuient sans réserve la société algérienne dans sa marche vers la justice et les libertés.
Premiers signataires : Lahouari Addi (sociologue), Hocine Aït-Ahmed (président du Front des forces socialistes), Omar Benderra (économiste), Sihem Bensedrine (Conseil national pour les libertés en Tunisie), Anna Bozzo (historienne), François Gèze (éditeur), Burhan Ghalioun (politologue), Ghazi Hidouci (économiste), Alain Lipietz (député européen), Gustave Massiah (président du CRID), Salima Mellah (Algeria-Watch), Adolfo Perez Esquivel (Prix Nobel de la paix), Werner Ruf (politologue), Salah-Eddine Sidhoum (chirurgien).
Signatures à adresser à : impunite_non@algeria-watch.org
Cette pétition sera envoyée à la fin du mois d’avril à diverses institutions algériennes et internationales.
—————————————-
Algeria
: Against Self-amnesty – Yes to Justice, No to Impunity!
23 March 2006
On 27 February 2006, the Algerian regime passed a law implementing provisions of the “Charter for Peace and National Reconciliation” (adopted in September 2005 by a referendum whose results were rigged). On the pretence of ending the bloody period initiated by the coup of January 1992, the Algerian Regime grants impunity for murderers, be they members of armed groups claiming to act in the name of Islam or “the web of defence and security forces of the Republic”. It also creates a new prisonable offence: attributing any responsibility to those who organised violations of the law and order or covered up or justified the atrocities committed over the last fifteen years.
Parents of victims and families of the missing are compelled to remain silent as they are no longer able to lodge complaints for financial compensation, unless they are willing to “forget”, a shameful method in which outrage meets blindness. But how can the memory of the blood and horror that submerged Algerian society be erased? The second Algerian war – which brought to a climax the perverse and inhuman forms of guerrilla and counter-guerrilla developed during the independence war by colonial forces – left nearly 200,000 dead, 20,000 missing, and a very high number of wounded and displaced persons.
After imposing a deadly and particularly “dirty” war on the Algerian people, the generals responsible for the coup and who hold the real power in Algiers (President Abdelaziz Bouteflika being only their diplomatic representative) are eager to absolve themselves for crimes against humanity that were perpetrated under their authority and to erase those of their former adversaries. In direct violation of international commitments signed by
This unacceptable machination, with the assent of many great Western democracies, is a great comfort to the regime in
The freedom loving men and women throughout the world and signatories of this text reject this outdated law and give unconditional support to the Algerian society in its journey towards justice and freedom.
First signatories: Lahouari Addi (sociologist), Hocine Aït-Ahmed (President of the Front des Forces Socialistes), Omar Benderra (economist), Sihem Bensedrine (Conseil National pour les Libertés en Tunisie), Adolfo Perez Esquivel (Nobel Peace Prize), François Gèze (editor), Burhan Ghalioun (sociologist), Ghazi Hidouci (economist), Gustave Massiah (President of CRID), Salima Mellah (Algeria-Watch), Werner Ruf (political scientist), Salah-Eddine Sidhoum (surgeon).
Address for signatures : impunite_non@algeria-watch.org
Commerce: l’UE souhaite une plus grande intégration des pays méditerranéens
Par Philippe RIES
AFP, le 23.03.2006 à 16h19
BRUXELLES, 23 mars 2006 (AFP) – L’Union européenne saisira l’occasion de la 5ème conférence des ministres du Commerce de l’Euromed, vendredi à Marrakech (Maroc), pour pousser à une plus forte intégration entre pays de la rive sud de la Méditerranée, gage de stabilité politique et économique dans la région.
Le commissaire européen au Commerce Peter Mandelson, qui sera présent à Marrakech avec les ministres du Commerce des Etats membres, a rappelé que l’objectif numéro un de ce processus était la création en 2010 d’une zone de libre-échange entre les 25 et leurs dix partenaires riverains de la Méditerranée, du Maroc à la Turquie.
“C’est tout à fait réalisable, en tout cas certainement le plus gros de l’accord”, a-t-il confié à quelques journalistes.
“Mais l’autre objectif commercial, c’est une plus forte intégration entre les pays du sud de la Méditerranée eux-mêmes”, a-t-il dit, en regrettant que cette partie du monde soit de ce point de vue très en retard sur d’autres régions.
“Ils y perdent en échanges commerciaux, en croissance économique et en intégration”, a-t-il estimé. Le commerce intrarégional ne représente actuellement que 15% du total des échanges de la région.
Le commerce n’est que l’une des corbeilles du processus dit de Barcelone, qui associe l’UE à ses voisins méditerranéens, et dont le 10ème anniversaire a été célébré dans la capitale catalane à l’automne dernier.
“C’est une politique destinée à stabiliser une région qui nous est très proche”, rappelle un responsable européen.
Soutenus par un désarmement tarifaire progressif, les échanges entre les deux rives de la “Grande Bleue” ont connu une croissance régulière. En 2004, l’UE était le plus important partenaire commercial des pays méditerranéens, comptant pour environ 45% de leurs exportations (soit quelque 40 milliards d’euros) comme de leurs importations (42 mds d’euros).
Mais ces dix pays rassemblant plus de 175 millions d’habitants, et dont la croissance s’est fortement redressée depuis 2001, pèsent pour 5% seulement des échanges extérieurs de l’UE.
A Marrakech, les Européens plaideront notamment pour un développement des échanges de services, un secteur qui représente 70% du PIB en Jordanie et au Liban, 60% en Tunisie, 50% en Egypte, au Maroc et en Syrie.
L’UE estime que le potentiel de développement à l’échelle de l’Euromed est considérable et ses responsables citent des études de la Banque Mondiale qui indiquent que la libéralisation des services augmenterait de 13% le PIB égyptien, de 21% si elle s’accompagnait d’un accès ouvert aux marchés européens.
Les Européens plaident aussi pour une libéralisation des régimes d’investissement chez leurs voisins de la rive Sud, en notant que depuis 2000 ils n’ont attiré que 1% en moyenne des flux européens d’investissement direct étranger.
Un autre dossier sensible est celui du textile, les producteurs de Tunisie et du Maroc, où ce secteur pèse très lourd dans l’activité industrielle, ayant souffert depuis janvier 2005 d’une concurrence chinoise renforcée par la fin des quotas textiles.
M. Mandelson reste attaché à l’idée “de transformer l’ensemble du bassin méditerranéen en une usine unique” dans le secteur textile, afin d’aider les industriels des deux rives à affronter la concurrence asiatique.
L’UE et ses partenaires sont ainsi en train de mettre en place la consolidation régionale des règles d’origine à l’échelle de l’Euromed, qui fera qu’une pièce de tissu marocaine pourra être coupée en Tunisie, finie en Turquie et exportée vers l’UE à un tarif douanier préférentiel.
L’UE a par ailleurs créé un forum pour aider les producteurs méditerranéens à diversifier leurs méthodes de fabrication et à augmenter la qualité de leurs produits textiles.
Euromed: libéraliser les services en vue d’une zone de libre-échange
Privatisation de Tunisie Télécom:
France Télécom hors jeu
Associated press, le 24.03.2006 à 15h51
TUNIS (AP) — Donné favori ces derniers jours par des échos de presse pour le rachat de 35% du capital de l’opérateur public Tunisie Télécom (TT), France Télécom s’est finalement retrouvée en hors jeu, son offre étant inférieure à celles de ses principaux concurrents.
Désormais, sur les six candidats de départ, seuls deux groupes, Vivendi Universal (France) et Tecom-Dig (Dubai), demeurent en course vendredi dans ce qui est considéré à Tunis comme “la transaction du siècle”.
Ils ont présenté les meilleures offres, respectivement de 2,440 milliards de dinars tunisien et de 2,377 MDT (1 euro = 1,64 dinars), selon le ministère tunisien des télécommunications qui chapeaute l’opération.
L’offre commune du saoudien Saudi Oger et Télécom Italia (offre commune) a porté sur 2,123 MDT, alors que celle de France Télécom a été de 2,107 MDT. L’Emirati Etisalat et le Sud-africain Mobile Téléphone étaient également en lice avec des offres inférieures.
VU et Tecom sont, conformément à la réglementation en vigueur concernant les appels d’offres, invités, dans le cadre d’un second tour, à présenter une offre améliorée le 29 mars 2006, précisait-on de même source.
L’ouverture définitive des plis aura lieu le même jour à 18h00, en séance publique à Tunis.
L’opérateur public TT, unique fournisseur de services de téléphonie fixe en Tunisie mais qui partage le marché de la téléphonie mobile avec un opérateur privé, Tunisiana, compte 1,2 million d’abonnés au réseau fixe et plus de 2,5 millions à son réseau mobile.
Ouverture à Marrakech de la Conférence Euromed des ministres du commerce
AFP, le 24.03.2006 à 10h54
MARRAKECH (Maroc), 24 mars 2006 (AFP) – La cinquième Conférence euro-méditerranéenne des ministres du Commerce s’est ouverte vendredi à Marrakech (sud) avec au menu des discussions les questions agricoles, les services et l’intégration régionale.
Une stratégie pour la mise en place de la zone de libre-échange Euromed à l’horizon 2010 doit également être définie.
Des représentants de la Commission européenne et le Premier ministre marocain Driss Jettou figurent parmi les participants, a constaté l’AFP.
Les moyens de développer les échanges des produits agricoles et des services dans la zone euro-méditerranéenne qui compte 35 pays devraient être examinés, tout comme l’intégration régionale dans le cadre du processus de Barcelone initié en 1995.
Peter Mandelson, commissaire européen chargé du commerce, a déploré qu'”aujourd’hui, les pays du sud méditerranéen attirent moins de 2% des investissements étrangers de l’UE”. “Il faut changer cette situation”, a-t-il dit en appelant à “aller plus loin en ouverture de marchés, d’intégration économique” et à créer “un véritable marché régional”.
“D’ici 2010 – date prévue pour la zone de libre-échange Euromed -, il nous reste cinq années de travail sérieux et soutenu si nous voulons réussir”, a déclaré M. Mandelson.
M. Jettou a souligné de son côté “l’attachement du Maroc aux principes et aux objectifs du processus de Barcelone”.
“Réaliser ces objectifs suppose que nous soyons capables d’assurer un équilibre réel entre les aspects sécuritaires, économiques, financiers et sociaux de notre coopération”, a ajouté le Premier ministre.
M. Jettou a indiqué qu’un accord sur la création d’une zone de libre échange entre le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et la Jordanie devrait “incessamment entrer en vigueur”.
La réunion des ministres du commerce de la zone Euromed devrait s’achever vendredi en fin d’après-midi.
LANCEMENT D’UN NOUVEAU SITE DEDIE AU RESISTANT TUNISIEN
LAZHAR CHRAITI
50 ème ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE TUNISIENNE
L’Indépendance de la Tunisie est proclamée en 1956, elle a été acquise de haute lutte.
L’histoire de son acquisition pourtant perdure. Une certaine part de celle-ci n’est toujours pas révélée : Lazhar Chraiti, comme d’autres hommes, a été mis à mort en janvier 1964. A ce jour, les raisons et les circonstances de sa mort ainsi que le lieu de son inhumation restent inconnus.
Ce site est destiné à recueillir témoignages et autres informations afin que les événements durant cette période soient décrits et les faits reconnus. Alors seulement, la mémoire de ceux qui ont contribué à l’indépendance de la Tunisie pourra être honorée.
. Ces héros de la résistance dont on ne sait pas jusqu’à présent où ils sont enterrés, l’accès aux archives nationales est exclu malgré la prescription
. Un silence qui en dit long sur les dossiers secrets de la période post-indépendante. Quelle indépendance ?
Pour en savoir plus : http://www.lazharchraiti.org
——————————————————
Article publié par le journal français « Le Monde » en 1954
LE GRAND CHEF
La tête de cet homme est mise à prix. Lazhar Chraïti est considéré comme le grand chef des fellaghas, deux millions de récompense sont promis à celui qui le capturera mort ou vif. Il a personnellement participé à plus de dix attaques contre des Français. Et on le soupçonne d’avoir ourdi bien d’autres attentats : Signalement de Lazhar Chraïti : né à Amra près de Gafsa ; taille : 1 m . 68 : particularité : porte un point bleu tatoué sur le milieu du front.
Fervent patriote, il s’opposa aux troupes coloniales françaises en Tunisie. Dès son plus jeune âge il espérait une Tunisie libérée. Il sera bien vite le chef de plus de 2000 combattants sur le terrain.
En 1948 il participera à la guerre de libération de la Palestine et fort de cette expérience, de retour en Tunisie, il organisera la lutte et la fondation de combattants fellagah avec Sassi Lassoued. Il a inlassablement milité pour la résistance à l’occupant et pour la mémoire des fellagahs morts aux combats. Il poursuivra sa vie durant son engagement courageux, intransigeant quant aux libertés des Tunisiens.
Les fellagah: ces oubliés de l’histoire Tunisienne
Qui sont les fellaghas ? Des hommes du peuple, pour la plupart des régions du Sud. Mineurs, paysans, les mains trempées dans la terre du matin au soir, amenant leur pain quotidien à la sueur de leur front, ils ont su prendre leurs armes quand le pays a eu besoin d’eux, et se battre. Cachés dans les montagnes de Gafsa, sautant des trains en marche pour échapper aux soldats français, harcelés, pourchassés, tête mise à prix, ils ont été soutenus par les civils parce que leur cause était juste, celle du mouvement nationaliste pour l’indépendance du pays. Qui sont-ils aujourd’hui ? Les oubliés de l’histoire. Mais c’est bien ce peuple là qui s’est aussi battu pour son indépendance. Il est temps de rendre justice à tous ces fellaghas et leur famille, et leur donner la place qu’ils méritent et la reconnaissance historique qui leur revient.
« On distingue 3 périodes dans le mouvement fellagha. La première de janvier 1952 à septembre 1953 fut marquée par la création, le renforcement et l’organisation des « bandes » ainsi que leur implantation géographique dans le Sahel, Gafsa, Gabès et les territoires militaires. Bien encadrés et bien armés, les fellaghas de la région de Gafsa se spécialisèrent dans les attaques contre les militaires et contre les moyens de communication.
On assista au regroupement des forces de fellaghas et à la mise en place d’un dispositif tactique «dont tout donne à penser qu’ils sont exécutés en vertu d’un plan préétabli ». Les principaux chefs étaient S. et T Lassoued ainsi que L. Chraïti. A partir de mars 1954, le mouvement se développa et s’étendit à la quasi-totalité du pays. La tactique des fellaghas ressemblait à celle de la guérilla.
Pierre Mendes-France et la proclamation de l’autonomie interne.
En mai 1953, P. Mendes-France n’avait pas caché son désir de trouver une solution aux problèmes tunisien et marocain, il se disait prêt à accueillir « les partisans sincères de la réconciliation » il désignait par là le néo destour, mais l’ensemble de la classe politique française prit peur et il ne fut pas investi en juin 1953, mais un an plus tard. Il créa le ministère des Affaires marocaines et tunisiennes.
Ben Youssef en exil au Caire s’attachait à démontrer dans sa lettre adressée au Conseil National le 12 novembre qu’il était nécessaire de « Soutenir les fellaghas, comme moyen de pression pour aller plus loin que ne l’avait promis Mendes-France, c’est-à-dire l’indépendance totale… » (38)
Les ministres tunisiens reconnaissaient seulement la nécessité d’un retour à l’ordre par une action commune des autorités françaises et tunisiennes. Ainsi fut composé vingt deux groupes qui devaient rencontrer les » fellaghas en des points précis pour leur proposer l’aman et leur demander de déposer les armes. » (40)
L’appel lancé aux fellaghas en novembre 1954 fut un succès presque total. La délégation franco-tunisienne avait pu obtenir d’eux le dépôt de leurs armes dans plusieurs régions comme le Kef, Gafsa… Les deux principaux chefs, S. Lassoued et L. Chraïti, acceptaient de répondre à l’appel commun. En décembre 1954, plus de 2500 fellaghas avaient fait leur soumission, les armes livrées provenaient presque toutes de l’armement abandonné par l’armée allemande lors de la campagne de Tunisie en 1942-43. Simultanément, Mendès-France put faire état devant l’Assemblée nationale de la reddition des fellaghas et du rétablissement de l’ordre.
Le protocole du 20 mars 1956 proclama l’indépendance et reconnut la souveraineté de l’Etat tunisien.
(38) Casemajor : « Rapport… »,op,cit..Nov. 1954/291
(40) Note-entretien Fouchet-amb.des Etats-Unis à Paris.22.11.1954/772.00
TUNISIE Les chemins vers l’indépendance (l945-1956) Samya EL MECHAT
——————————————————
Les ratissages du cap Bon
par Patrick Girard
La décolonisation de la Tunisie faillit être aussi sanglante que celle de l’Algérie. Les militaires français y inaugurèrent la chasse aux fellaghas.
En 1950, des conversations s’étaient ouvertes entre le gouvernement français et les nationalistes tunisiens du Néo-Destour dirigé par Habib Bourguiba. Un accord fut signé, prévoyant la constitution d’un gouvernement tunisien homogène et l’élection d’une Assemblée représentative. Nommé Premier ministre, Mhamed Chenik se heurta à la mauvaise volonté du Quai d’Orsay, ministère de tutelle des protectorats maghrébins, et, devant le blocage de la situation, décida de faire appel à l’ONU en janvier 1952.
En réponse, le nouveau Résident, le général Jean de Hauteclocque, cousin du maréchal Lelerc, décida d’employer la manière forte. Il fit interdire la tenue du Congrès du Néo-Destour, assigna ses dirigeants à résidence et, surtout, lança de vastes opérations de ratissage dans la région du cap Bon, à une soixantaine de kilomètres de Tunis, foyer traditionnel d’agitation.
Du 20 janvier au 1er février, le cap Bon fut investi par l’armée française, placée sous le commandement du général Garbay, qui avait déjà fait ses « preuves » en 1947 à Madagascar : pillages, destructions, exécutions sommaires, viols de femmes et de jeunes filles, etc..Le grand jeu. Sans résultat.
C’est alors que des groupes de fellaghas se constituent et sèment la terreur aussi bien dans les villes qu’autour des fermes isolées des colons, provoquant l’engrenage terrible du terrorisme et de la répression aveugle. Jusqu’à ce que Pierre Mendès France, par son célèbre Discours de Carthage, le 31 juillet 1954, ramène le calme, octroyant enfin à la Tunisie l’autonomie interne promise en 1950.
(Source : un article publié dans un dossier intitulé « Colonialisme : L’Histoire au garde-à-vous » publié par le magazine français « Marianne » le 30 mars 2005)
مقتطفات من الموقع باللغة العربية
أ ُعلن استقلال تونس في سنة 1956 ، بعد نضال طويل. فقد استغرق حصولها على الاستقلال وقتا” طويلا”. وإن حقبة من تاريخ تونس لم يكشف عنها النقاب بعد: فالأزهر الشرايطي ، الذي أ ُعدم مع آخرين في كانون الثاني/ يناير من سنة 1964، مازالت أسباب وظروف مقتله فضلا” عن مكان دفنه أمرا” مجهولا”.
يهدف هذا الموقع إلى جمع المعلومات والأدلة من أجل سرد الأحداث التي جرت في هذه الفترة والتعرف إلى الوقائع. في ذلك الوقت فقط ، يمكن أن تخلد ذكرى أولائك الذين ساهموا في استقلال تونس.
النضال
صحيفة “لوموند “، سنة 1954
خصصت مكافأة تبلغ مليونين للشخص الذي يأسر الأزهر الشريتي الذي يعتبر الزعيم الأكبر ” للفلاّقة”، حياً أم ميتاً. فقد شارك في أكثر من هجوم على الفرنسيين ويقال أنه دبّر غارات أخرى.
وُلد هذا القائد في منطقة عمرة قرب قفصة. ويتميز بعلامة وشم أزرق تتوسط جبهته . كان منذ حداثة سنه يطمح إلى تونس حرّة. إلى أن قاده حماسه الوطني إلى التصدي إلى قوات الاستعمار الفرنسي في تونس . وهكذا يصبح خلال فترة وجيزة على رأس أكثر من ألفي مقاتل .
في سنة 1948 شارك في حرب تحرير فلسطين. وكان لهذه التجربة وقعاً كبيراً في نفسه حمله، إثر عودته إلى تونس ، على تنظيم الكفاح وإنشاء مقاتلي الفلاّقة، إلى جانب ساسي الأسود. فكافح بلا هوادة من أجل مقاومة المحتل ولتخليد ذكرى رفاقه الفلاّقة الذين استشهدوا على ساحة القتال . وهكذا نذر هذا القائد حياته للنضال بإرادة لا تنثني من أجل منح الشعب التونسي حريته.
الفلا ّقة : هؤلاء الذين غفـلهم التاريخ التونسي
الفلا ّقة هم أفراد من عامة الناس، يأتي معظمهم من جنوب تونس،عمال مناجم و فلاحون تشبّعت أياديهم بتراب أرضهم، يجنون رزقهم اليومي بعرق جبينهم. إلاّ أنهم استطاعوا حمل السلاح والقتال تلبية ً لنداء الوطن ولاستقلاله. آن الأوان إنصاف هؤلاء الفلاقة وأسرهم ومنحهم المكانة التي يستحقونها وعرفان التاريخ لما بذلوه.
تتميز حركة الفلاقة بثلاث فترات. تمتد الفترة الأولى من يناير/كانون الثاني 1952 إلى سبتمبر/ أيلول 1953 وتتميز بإنشاء وتعزيز وتنظيم “العصابات” فضلاً عن توزعها الجغرافي في السهل و قفصة وجابس والمناطق العسكرية. وتخصصت فلاقة منطقة قفصة، وهي مجموعة قد أحسن تنظيمها وتسليحها، في الهجمات التي تشنها ضد العساكر ووسائل الاتصال. والقائدان الرئيسيان لهذه المجموعة هما ساسي الأسود والأزهر الشرايطي. بدأ ً من شهر مارس /آذار 1954 تطورت الحركة لتشمل ما يقرب إلى غالبية تونس.
تونس والمسيرة نحو الاستقلال (1945 – 1956)، سلمى المشاط
حاصر الجيش الفرنسي منطقة رأس بون (كاب بون) لفتؤة امتدت من 20 يناير/ كانون الثاني إلى 1 فبراير/ شباط ووضعتها تحت قيادة اللواء جاربي الذي سبق له أن ” أثبت مهارته” في مدغشقر سنة 1947، في أعمال السلب والتدمير والإعدامات التعسفية واغتصاب النساء والفتيات …. إلى كل ما هنالك من فظائع، دون جدوى.
في ذلك الوقت، تشكلت فرق الفلاقة لتحدق الرعب في المدن وحول المزارع المعزولة للمستعمرات، مما أدى إلى وقوع مجموعة مريعة من أعمال الإرهاب والقمع العشوائي. ولا يستقر الوضع إلى أن يدلي بيير مندس فرنس خطابه الشهير في 31 يوليو/ تموز 1954 في قرطاج، يمنح فيه، في آخر المطاف، السيادة الداخلية لتونس، الموعودة بها منذ سنة 1950 .
30/ 03/ 2005، عن باتريك جرار
معركة بنزرت
كي يرفع من شأنه أمام الثوريين الجزائريين وأمام العالم العربي، قرر بورقيبة أن ينجز مأثرة عظيمة ألا وهي قاعدة بيرزت وهي آخر حصن للفرنسيين في الأراضي التونسية وذات موقع استراتيجي مهم حيث تشكل منطقة استطلاع ومراقبة لكل الحركة الملاحية بين مضيق جبل طارق والشرق الأوسط . في منتصف يونيو/ حزيران 1961 يطلب بورقيبة من الفرنسيين الجلاء عن هذه القاعدة. لكن الجنرال دوغول لم يكن مستعداً للتنازل عنها بهذه السهولة. وهكذا تنشب معركة ذات شراسة لا مثيل لها بين العسكريين الفرنسيين والفرق التونسية، تستخدم فيها شتى الأسلحة و وسائل القتال، من جنود المشاة والمظليين الى الطيران الحربي. وينفذ طيران البحرية أكثر من 150 طلعة جوية. وفى 15 اكتوبر/ تشرين الاول 1963 يعلن قائد المدفعية لويس مولر عن استسلامه. وبهذا يضع حداً الى 28 عاماً من الوجود الفرنسي في قاعدة بيرزت.
انقلاب سنة 1962
منذ 40 عام في ديسمبر/ أيلول 1962 توصل الى أسماع سكان تونس وقوع محاولة انقلاب شارك فيها ضباط من الجيش الوطني وعدد من المدنيين. والأزهر الشريتي شارك أيضاً في هذا الانقلاب، فقد كان يأخذ على رئيس الدولة أمر تغافله لرجاله الذين قاتلوا في سبيل تحرير تونس، فضلاً عن سياسة القمع التي فرضها على الشعب التونسي. الا ّ أن خطة الانقلاب تفشى وتبوء المحاولة الى الفشل.
لجنة رد الإعتبار
تضم هذه اللجنة كل إنسان يحرص على تطبيق حقوق الإنسان الأساسية ومنطلقاً من ذلك، تتوجه إلى الحكومة التونسية الحالية بالطلب التالي:
– الحصول على محفوظات الأمن الوطني كما تخوله مهلة التقادم.
– تحديد هوية الجثث من أجل منحها مراسم دفن تليق بها.
– والحصول على كل الحقوق المنبثقة عن رد الاعتبار هذا.
سيبقى هذا القبر الافتراضي قائماً، طالما لم يشيد قبر حقيقي تخليداً لذكرى الأزهر الشرايطي
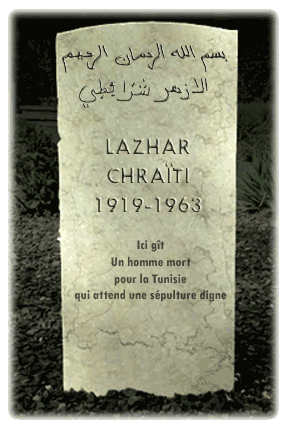
(المصدر: موقع http://www.lazharchraiti.org/ بتاريخ 24 مارس 2006)
Sabra et Chatila : les tueurs parlent
Une étude américaine critique la politique pro-israélienne des Etats-Unis
WASHINGTON CORRESPONDANTE
Dans un essai intitulé Le lobby israélien et la politique étrangère des Etats-Unis, les professeurs Stephen Walt, directeur des études à la Kennedy School de l’université Harvard, et John Mearsheimer, professeur de sciences politiques à l’université de Chicago, estiment que les Etats-Unis confondent trop souvent leur intérêt national avec celui de l’Etat juif au risque de “compromettre leur sécurité”. Ils incriminent l’action du “lobby pro-israélien”, un groupe qu’ils définissent comme composé d’individus et d’organisations qui “travaillent activement” en vue d’influencer la diplomatie américaine.
“D’autres groupes d’intérêt ont réussi à tirer la politique étrangère américaine dans le sens qu’ils souhaitaient, mais aucun n’a réussi à l’emmener aussi loin de ce que l’intérêt national américain recommanderait, tout en réussissant à convaincre les Américains que les intérêts des Etats-Unis et d’Israël sont à peu près identiques”, écrivent les deux chercheurs.
Ce texte de 83 pages, placé sur le site Internet d’Harvard dans la série des “documents de travail”, n’a pas été retiré du site malgré les protestations des associations pro-israéliennes ; toutefois l’université a fait ajouter un paragraphe sur la page de garde indiquant qu’il n’engage que ses auteurs.
La thèse prend le contre-pied du raisonnement habituel aux Etats-Unis, selon lequel la menace terroriste a rapproché Israël et l’Amérique. Pour les deux universitaires, qui comptent parmi les animateurs de l’école “réaliste” en matière de politique internationale, si les Etats-Unis ont un problème de terrorisme, c’est “en bonne partie parce qu’ils sont alliés à Israël, non pas l’inverse”. De même, les Etats-Unis “n’auraient pas à s’inquiéter autant” de la menace irakienne ou syrienne, s’il n’en allait de la sécurité d’Israël. Un Iran nucléarisé ne serait pas un tel “désastre stratégique”, le régime de Téhéran sachant qu’il s’expose à une riposte foudroyante.
Depuis la fin de la guerre froide, estiment les chercheurs, Israël n’apparaît plus comme “un atout stratégique” aidant à contenir l’expansion soviétique dans la région, mais comme un “fardeau”. Pour les deux professeurs, qui étaient opposés à la guerre en Irak, le lobby a été, avec le gouvernement israélien, non pas l’unique facteur, mais “un élément critique” dans la décision de renverser le régime de Saddam Hussein.
“OPÉRATIONS D’ESPIONNAGE”
Les auteurs rappellent qu’Israël est le premier bénéficiaire d’aide économique et militaire des Etats-Unis, avec l’Egypte (environ 500 dollars par habitants par an), alors que son revenu par personne est équivalent à celui de l’Espagne ou de la Corée du Sud. Israël reçoit la somme en un seul versement, contrairement aux autres pays, ce qui lui permet de la placer et de toucher des intérêts. Les autres pays sont pour la plupart tenus de se fournir en équipements militaires auprès des Etats-Unis, ce qui n’est pas le cas d’Israël, qui fait vivre son industrie militaire.
L’Etat juif ne se comporte pas pour autant en “allié loyal”, accusent MM. Walt et Mearsheimer. Il a livré de la technologie sensible à la Chine. Les auteurs citent aussi un rapport de l’organisme budgétaire du Congrès (GAO), selon lequel Israël “se livre aux opérations d’espionnage les plus agressives contre les Etats-Unis, parmi tous les alliés”.
Deux membres de la principale organisation de lobbying, l’Aipac (American Israel Public Affairs Committee), qui se définit elle-même comme “le lobby de l’Amérique pro-israélienne”, sont poursuivis pour avoir livré des informations confidentielles sur l’Iran obtenues de l’analyste du Pentagone Larry Franklin. Larry Franklin a été condamné, en janvier, à près de treize ans de prison.
Dès parution, le texte a suscité des critiques virulentes, notamment sur la partie où il met en cause les cercles de réflexion et la presse pour leur partialité en faveur d’Israël. M. Mearsheimer a indiqué au Monde qu’aucune publication américaine n’a accepté de le diffuser.
Les deux chercheurs ont commencé leurs travaux en 2002 après avoir été frappés par la manière dont Ariel Sharon avait ignoré les demandes du président Bush de surseoir à la reprise de contrôle des villes de Cisjordanie, alors qu’une telle opération nuisait à l’image des Etats-Unis dans le monde arabe. “Notre ambition est de faire en sorte que les Etats-Unis suivent une politique qui sert l’intérêt national américain, dit-il. Nous ne pensons pas que la guerre en Irak correspondait à cet intérêt. Il nous a paru clair que cette politique était conduite pour une bonne part par le lobby israélien. Cela nous a paru de bon sens d’écrire là-dessus et d’ouvrir le débat.”
Corine Lesnes
(Source : « Le Monde » du 24.03.06)
Ils ont osé montrer leur Prophète
BEYROUTH CORRESPONDANTE
Jihad Al-Momani est passé en jugement le 9 mars. Quelques jours avant l’audience, l’ancien rédacteur en chef de Shihane – hebdomadaire jordanien qui tire à 20 000 exemplaires et tient son nom d’une montagne du sud de la Jordanie – affirmait avoir suffisamment de preuves pour convaincre le tribunal de son innocence. D’autant, faisait-il valoir, que “les tensions au niveau de la rue arabe ont baissé d’intensité”. Son crime ? Avoir publié dans Shihane certaines des caricatures du prophète Mahomet parues en septembre 2005 dans le quotidien danois Jyllands-Posten.
Rares sont les médias qui l’ont fait dans le monde arabe et musulman. Ceux qui s’y sont risqués se sont vu infliger des sanctions variables, selon les pays, allant de la suspension provisoire de la publication à des poursuites judiciaires contre ses responsables.
C’est vrai en Egypte, où le quotidien Akhbar Al-Yom s’est vu confisquer ses 40 000 exemplaires, déchirés un à un à la sortie de l’imprimerie, et où une enquête a été ouverte pour désigner l’auteur de la décision de reproduire les caricatures. C’est également vrai au Yémen, où quatre rédacteurs en chef sont poursuivis en justice, mais aussi au Maroc, où un journaliste du quotidien Annahar Al-Maghribia a été mis en examen, ainsi qu’en Algérie, où les directeurs des publications Errisala et Essafir sont en prison.
En Indonésie, le rédacteur en chef du tabloïd Péta a été inculpé pour blasphème, et, en Inde, son homologue du magazine Shabbarth a été suspendu. Et en Malaisie, trois publications, Berita Petang Sarawak, Guangming Daily et Sarawak Tribune ont été provisoirement suspendues.
Chronologiquement, c’est un quotidien égyptien, Al-Fagr, qui, le premier, dès le 17 octobre 2005, quelques jours seulement après la parution des caricatures au Danemark, a publié six des douze caricatures incriminées. Cela n’avait suscité aucune réaction, sans doute parce que l’Egypte était focalisée sur la campagne pour les élections législatives. Aujourd’hui, Adel Hammouda, le rédacteur en chef d’Al-Fagr, refuse de s’exprimer et se borne à déclarer de manière elliptique : “Toute cette histoire ne m’a valu que des problèmes.”
En Jordanie, l’hebdomadaire Shihane n’a pas non plus été le premier à le faire. Quatre autres publications, The Star, Al-Haq, Al-Anbat et Al-Liwa – ce dernier étant de tendance islamiste – l’avaient précédé sans être inquiétées. Aussi Jihad Al-Momani, 46 ans, était-il à des lieues de prévoir que son initiative soulèverait un tollé. Il a été aussitôt congédié, arrêté par la police pendant vingt-quatre heures, puis interpellé à nouveau quelques jours plus tard pour être hospitalisé pendant treize jours pour un léger problème cardiaque, avant d’être laissé libre.
Shihane a joué de malchance. Lorsque l’hebdomadaire a publié certains des dessins danois, la colère était à son comble dans le monde musulman. “Les manifestations succédaient aux manifestations, l’indignation était générale, et ce climat a pesé contre l’hebdomadaire”, déclare M. Al-Momani.
L’initiative d’un “employé de la société éditrice” de l’hebdomadaire a mis de l’huile sur le feu, puisque, selon Jihad Al-Momani, ce responsable de la distribution s’est empressé de retirer les numéros de la vente et d’annoncer sur des télévisions satellitaires arabes que le rédacteur en chef serait relevé de ses fonctions. Bien que les responsables de la Compagnie des imprimeurs arabes, société éditrice, n’aient pas été consultés par l’employé zélé, le conseil d’administration “a été forcé de suivre”, compte tenu de “la tempête” soulevée par l’affaire, indique M. Al-Momani. Le gouvernement aussi, “qui n’avait pas d’autre choix”, puis, dans une réaction en chaîne, le syndicat de la presse, le conseil de l’information et jusqu’au cabinet du roi – lequel, faut-il le rappeler, est un descendant du prophète – ont stigmatisé la publication.
Certains médias étrangers ayant affirmé que Shihane était le premier journal arabe à reproduire les caricatures, “j’ai été pris dans un cyclone, alors même que je refuse et ai toujours refusé d’accorder la moindre place à l’incitation à la haine ou au terrorisme, et que je ne cherchais ni à faire un coup médiatique ni à tester les limites de la liberté de la presse”, assure l’intéressé. Aux yeux de Jihad Al-Momani, la liberté d’_expression s’arrête “aux religions et aux prophètes”.
“Je cherchais à informer les lecteurs, tout en rappelant, dans un éditorial, que nous avons connu pire, que le Coran a été jeté dans les toilettes à Guantanamo, qu’Israël a transformé des mosquées en bars. Et j’invitais les lecteurs à s’interroger si ces caricatures injustifiées, stupides, indignes et méprisables étaient plus nuisibles à l’islam que l’égorgement d’innocents coréens, américains ou autres en Irak par un Abou Moussab Al-Zarkaoui qui hurle “Allahou akbar” (Dieu est grand), ou encore qu’un attentat-suicide en plein mariage à Amman. Je leur demandais aussi de s’interroger sur pourquoi le monde musulman a réagi cinq mois après la publication de ces dessins”, plaide encore le journaliste, dont l’éditorial était titré ce jour-là “Musulmans du monde, soyez raisonnables”.
“Nous avons besoin de rationalité. La raison doit prévaloir”, dit encore aujourd’hui M. Al-Momani, pour qui il serait mieux d’agir plutôt que de toujours réagir à l’événement. “Les caricatures danoises sont méprisables, mais nous, nous savons que le prophète est lumière. Nous devons montrer le vrai visage de l’islam. Nous autres musulmans sommes plus d’un milliard d’hommes. Comment accepter d’être désignés comme des terroristes ?”, s’indigne-t-il, tout en “n’excluant pas” que les musulmans soient tombés dans un piège tendu par “Israël et les sionistes aux Etats-Unis”, lesquels veulent bâtir “un mur” entre le monde musulman et l’Occident.
Si le tribunal le juge coupable d’avoir “offensé le sentiment religieux”, M. Al-Momani est passible de trois mois de prison. Il risque, en revanche, une peine plus lourde, de trois ans d’internement, si le département des publications et de l’édition – un organisme officiel – lui intente un autre procès pour incitation aux dissensions confessionnelles, au blasphème des prophètes et de la religion.
Hachem Al-Khalidi, le rédacteur en chef du tabloïd jordanien Al-Mehwar, poursuivi lui aussi en justice pour les mêmes raisons, ne veut pas, pour sa part, s’exprimer sur cette affaire.
Mouna Naïm (avec Florence Beaugé à Alger, Cécile Hennion au Caire et Sophie Shihab à Sanaa)
(Source : « Le Monde » du 24.03.06)

